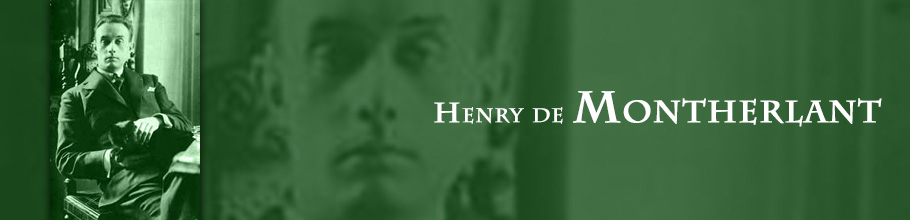
Biographie
4. Guerre de 40-45
L’avant-guerre du 15 septembre 1938 au 2 octobre 1938, et les Accords de Munich
Montherlant rédige le Journal de ses observations et de ses indignations face à la crise internationale, aux menaces d’Hitler, aux réponses des gouvernements occidentaux. Il observe sur le terrain l’attitude de la population française, et la résignation de la troupe en état de “semi-mobilisation”. Tous les extraits de ce Journal (du 15 septembre au 2 octobre 1938) sont tirés de L’Equinoxe de septembre, publié en décembre 1938 (Essais, Pléiade, p. 793 à 834).
Il est passionnant de lire Montherlant dans une période de grande tension internationale, afin de connaître ses réactions, car il ne reste pas passif. Les premiers réservistes sont rappelés. Montherlant apprend cela à Londres où il se gorgeait des beautés du British Museum.
“A Londres, j’achetai vivement un fameux quotidien. Un titre en grandes majuscules couvrait la moitié de la première page : “Garbo needs carot juice”. Il me fallut cinq minutes pour découvrir, à la dixième ou trentième page, l’annonce du début de notre mobilisation.”
Il rentre à Paris. Les alertes lui sont bénéfiques. Il peut se consacrer davantage à son travail d’écrivain.
“(…) Les gens, préoccupés, me fichaient la paix. Quelle merveille que ces heures libres pour le travail, au milieu de l’obscène cacophonie !”
Le 15 septembre, il apprend que Chamberlain rencontre Hitler à Berchtesgaden. “La peur donne des ailes”, écrit Montherlant. Depuis février 1936, Montherlant est prêt.
“Mon fourbi de mobilisation au complet, est disposé sur une table ad hoc. L’attache des boutons a été vérifiée, les lacets vérifiés, les godasses éprouvées, graissées, modelées à mon pied (…) De ce que j’emporte tout a été étudié ; rien qui manque et rien de trop ; le maximum de l’utile et de l’efficace dans le minimum de volume et de poids. Il n’est pas jusqu’à la jugulaire du casque qui n’ait été mise à la longueur convenable. Depuis deux ans et demi, en dix minutes, je peux filer.”
Il a un problème avec le masque à gaz. Il a fait confiance à son vendeur. Un laboratoire vérifie. Le masque est défectueux, trop large, l’air y entre, il faut le remplacer ! On voit un Montherlant très concentré, très perfectionniste, dans la préparation de son éventuelle mobilisation. Il a tout prévu, et son pessimisme ne s’étonne pas que le vendeur du masque à gaz, cet homme qui cherchait à préserver la vie de l’écrivain, fait ce qu’il faut pour qu’il la perde. “Il était léger, il était Français.”
Montherlant a 43 ans. Il est en “veille d’armes”. “Je suis belliciste, n’est-ce pas ? Ils le disent, eux, qui ne savent que faire de la paix (…), eux qui salopent la paix.”
 |
Le 20 septembre, la Tchécoslovaquie est sacrifiée. Montherlant cite cette réflexion hautaine d’Emile Faguet :
“Je souhaite de mourir avant de voir s’appesantir sur mon stupide pays le destin qu’il se prépare.”
Montherlant, tout guerrier qu’il se voit, pousse un soupir :
“Et nous, qui avons une œuvre à faire, indépendante des patries et des temps, et pourrions peut-être nous consacrer à quelque chose de plus important que nous faire tuer…”
Montherlant a décidé de partir aux frontières de l’Est. Dans un journal, il voit une photo des ministres français sortant d’un Conseil.
“Leurs visages sinistres, marqués par la fatigue, l’insomnie et le désarroi. L’un d’eux, ses yeux de fou. Tous, leur air épouvanté. On ne sait pas si c’est de la situation, ou d’eux-mêmes.”
Le 24 septembre, la Tchécoslovaquie mobilise. Montherlant décide de partir pour Metz.
“Je m’en vais à ma seconde guerre comme on s’en va à une partie de pêche. Courage ? Non, insensibilité.”
Gare de l’Est, foule d’hommes. Montherlant est frappé par le petit nombre de ceux qui sont accompagnés, et par le calme de tous.
“Ces milliers d’hommes en casquette, qu’on dirait réunis à l’occasion d’un meeting communiste, et qui partent vers ce qu’ils détestent le plus, - qui partent avec paix pour la guerre. Pas de cris contre l’Allemagne. Pas l’ombre de Marseillaise : La Marseillaise, ce chant inconnu. Et, ma foi, j’aime presque mieux cela.”
Les trains sont bondés, la chaleur est étouffante. Les officiers occupent les wagons de tête. Les hommes commencent à boire.
“A la brune, le nombre des hommes éméchés par la dinette vespérale menaça de corrompre un peu l’impression de dignité qui se dégageait de cette journée. Les officiers étaient abordés par des casquettards vacillants, soit pour d’extravagantes demandes de renseignements, soit pour des déclarations de cordialité. Amusantes à observer leurs réactions : paternelles et patientes chez les officiers d’âge, quelque fois un peu brusques chez les jeunes. Le plus drôle était la tête de ces dames des officiers : lèvres pincées, tandis qu’un métallo euphorique tape sur l’épaule de son capitaine de mari, Mme Soif d’Egards ne lâche rien de son rang, même en ces minutes-ci (…) Un des civils me dit : “Il faut espérer”. Je lui réponds : Il n’y a pas à espérer.”
Montherlant est frappé par le calme, le silence et la résignation des premiers soldats mobilisés. “Les hommes partent en silence, comme le train.” Dans ce lent voyage vers l’Est, Montherlant travaille aux Lépreuses tandis que les officiers et sous-officiers récitent leurs journaux “qui est le bout de leur capacité, et je me barde pour ne pas les entendre.”
Le 25 septembre : Gare de Metz. Il y passe la nuit à travailler à son roman.
“ (…) car les officiers avaient envahi tous les hôtels. (…) La vaste gare est sombre dans le petit jour. Les hommes qui, comme moi, n’ont pu rejoindre leurs cantonnements, dorment sur le sol, sur les marches. D’un certain point, mon regard n’embrasse que des hommes étendus : on les dirait morts, déjà. Morts dénués de sang, comme si c’étaient les gaz qui les avaient abattus. Et je me promène parmi ces dormeurs (…) Moi qui ne me sens à l’aise que parmi les obscurs : ceux de la guerre, ceux du sport, ceux du bled africain. L’enfouissement le plus profond, dans un vivier d’inconnus. Et faisant corps avec une de leurs passions. Leur passion ici est de tuer et n’être pas tué.”
Le 26 septembre : il est à Thionville dépeuplée. Il sent monter en lui une envie de pillage, tant il y a des maisons vides de leurs occupants.
“Insignifiance de la conversation des officiers (…) il y a ici des capitaines à ne savoir qu’en faire.”
Retour le soir à Metz. Il écoute le discours d’Hitler à la radio. Il ne comprend pas l’allemand. Il n’est pas impressionné.
“Que cette voix est proche ! Le seigneur de la guerre est là, dans cette pièce demain écrasée par ses obus. A plusieurs reprises, les “sieg heil !” déferlent, et c’est la grande rumeur de la mer. Mais (…) cela ne me fait aucun effet (…) les enthousiasmes ne m’imposent pas (…) le côté magique, incantatoire de cette cérémonie, le tambour samoyède rythmant les applaudissements, me rebroussent. Je devine trop les ficelles de tout cela.”
Le 27 septembre, Montherlant est à un kilomètre de l’Allemagne. Il voit les premiers ouvrages fortifiés et les premiers barbelés. C’est la ligne Maginot. Il constate le contentement des soldats.
“La guerre fait jouer un rôle aux gens qui ne sont pas capables de s’en fabriquer un eux-mêmes. Et ce rôle, quoi qu’on dise, est et sera éternellement, de ceux qui leur relèvent la tête.”
Montherlant va régler ses comptes. Il continue :
“Et puis, il y a quelque chose de si monstrueux dans le mariage, dans la vie de famille, que vous pouvez envoyer un homme à la mort, si d’abord ça le débarrasse de son foyer, il commence par se sentir en vacances (…) Libérez les hommes des foyers et des femmes, ils ne se détesteront plus.”
Montherlant n’est pas dupe. Il ne supporte pas l’attitude des démocraties peureuses face à Hitler.
“Les chefs des grandes démocraties accourant l’un après l’autre, gravissant l’Olympe en suppliants, pour embrasser les genoux du Jupiter à la mèche, suspendus à un froncement de ses sourcils, sans d’ailleurs prendre la peine de s’en cacher, le flattant du bout des doigts, tandis qu’ils font dans leur culotte.”
Montherlant croque Chamberlain, Premier Ministre anglais, “le parapluie, le faux col énorme, le pantalon trop court, le rictus que je me refuse à définir, font partie de la “composition de personnage” savamment étudiée, de notre Marx Brother de la Paix.”
 |
|
|
“Chamberlain, |
Le 28 septembre, il est à un jet de grenade de l’Allemagne.
“Pas une âme. La France et l’Allemagne reposaient côte à côte, comme deux sœurs endormies (…) Cela semblait cuit, cette fois tout de bon. La mi-temps de vingt années touchait à sa fin…”
Montherlant est persuadé que la guerre est imminente. Il ne se fait plus aucune illusion.
Le 29 septembre : coup de théâtre avec les Accords de Munich entre les quatre puissances !
C’est le miracle de la paix ! Montherlant ricane.
“Ce n’est pas de minutes de silence que nous avons besoin, c’est d’avions, monsieur Daladier.”
Le 30 septembre, Montherlant écrit :
“Qu’est-ce que cette impression de dérision qui monte en moi ? Elle vient de ce qu’un doute se glisse, si tout cela n’est pas et n’a pas cessé d’être une comédie Hitler-Mussolini.”
Le 1er octobre : Montherlant est choqué par cette paix qui lui semble factice. Il n’a plus rien à faire sur la frontière. Ce milieu (militaire) était supportable quand tournait au dessus de lui la mort. Il rentre à Paris. Il crie son dégoût aux Français.
“Délirez à votre aise, pauvres ilotes, manœuvrés et dupés, affaiblis, souffletés, et qui accueillez votre défaite et votre humiliation avec les transports de joie de l’esclave. Piétinez vos masques à gaz, imbéciles, car ce soir comme hier soir, c’est exact, il y aura le bifteck sur la table, et ensuite coucouche-mon-chéri. Mais vous m’en direz des nouvelles demain. Que vous le vouliez ou non, lâches imbéciles, un jour viendra où l’odeur de vos cagayes sera étouffée dans l’odeur de votre sang. A moins qu’éternellement, vous ne vous préserviez du sang par la honte.”
Hiver 1938-1939
Congestion pulmonaire qui l’empêchera de prendre une part active à la guerre qui approche.
29 novembre 1938 : Conférence très dure de Montherlant au Cercle Rive Gauche à Paris. En voici quelques extraits :
“La France fait cocorico, automatiquement, dirait-on, chaque fois qu’elle reçoit un coup de pied quelque part, à la façon de ces cibles en forme de coq, dans les tirs forains, qui coqueriquent quand le tireur les a atteintes. Climat de dégonflage perpétuel, dégonflage du particulier devant le particulier, dégonflage des gouvernants devant le groupe et devant l’extérieur (…) On larmoie sur la “sécurité”, on l’implore de ses alliés, voire de ses anciens adversaires, mais on n’exige pas de ses gouvernants que la défense nationale soit au point, ni qu’ils vous protègent, vous, vos femmes, vos enfants, contre les gaz, ni qu’ils mettent un terme au désordre social ou à l’envahissement des étrangers (…) Certains notables de notre pays (note = les Académiciens !) portent un costume vert, afin de bien montrer - exemplairement - que c’est par la verte peur qu’ils sont parvenus à leur haute situation ; peur de déplaire, peur de se faire des ennemis, peur de ne pas penser comme tout le monde, peur de peindre la réalité, peur de dire la vérité (…) Résultat : le mot d’ordre national : “Pas d’histoire !”. La maladie nationale : l’inhibition.”
Décembre 1938
Hommage public à Montherlant au théâtre Pigalle à Paris. On monte le fragment de pièce qu’est Pasiphaé (cette pièce fut publiée en 1936 à Tunis à 300 exemplaires). Ellle sera religieusement écoutée et applaudie. Pasiphaé, femme du Roi Minos, personnage de la mythologie, folle d’amour pour un taureau, et prête à braver tous les interdits pour satisfaire sexuellement sa passion, au risque de sa vie et de sa réputation de Reine !
Texte d’une interview que Montherlant donna à Frédéric Lefèvre le 15 novembre 1927, pour expliquer le thème de cette tragédie :
“Dans le rêve, nous nous métamorphosons en d’autres êtres, et nous avons une conscience simultanée de ces diverses personnalités. Dans le rêve, nous sommes “totalistes”. Combien de fois la nuit, en rêve, ai-je été un lion, un serpent, un taureau, gardant assez de conscience pour savoir que j’étais cette bête et pour l’observer, mais cependant étant cette bête avec une telle intensité hallucinatoire que, parfois, réveillé en sursaut, je cherchais sur le bois du lit l’éraflure de ma corne ou les déchirures de mes griffes sur les draps”. (Les Nouvelles littéraires, Une heure avec Montherlant, 15 novembre 1927).
André Gide dira, à propos de Pasiphaé :
“Quand Montherlant, ce bougre-là, n’aurait écrit que ces trente pages, cela suffirait pour que son nom passât dans la littérature française pour toujours.”
Cette pièce, montée à la Comédie Française, en 1950, fut un échec, car mal distribuée, mal mise en scène, et la pièce ne fut jamais reprise.
“On me dit qu’elle suffira à faire passer mon nom à l’immortalité, dit Montherlant, mais elle n’est jamais jouée, absolument jamais, par personne.” (Archives du XXe siècle, p.64).
Publication de L’Equinoxe de septembre, en décembre 1938. Cet essai reprend des textes qui se rapportent tous, directement ou indirectement, aux évènements de 1938 (cf. textes ci-dessus).
En juillet 1939 : Publication du quatrième et dernier tome des Jeunes Filles - Les Lépreuses.
En janvier 1940, il est à Marseille. Il est malade, et craint une nouvelle congestion pulmonaire. Il revient à Paris début mars 1940.
Le 10 mai 1940, Montherlant, qui n’a pas de radio, apprend de son ami l’Ambassadeur du Pérou à Bruxelles, Ventura Garcia Calderon, que la guerre a éclaté.
Quand la Guerre éclate, en mai 1940, il devient correspondant de guerre
Montherlant a 45 ans. Il n’est plus mobilisable. Il cherche “vaguement” à s’engager dens la Croix-Rouge, mais il est refusé, et il en est heureux car “je n’avais rien à voir avec les choses médicales”.
Le Rédacteur en chef de Marianne, André Roumeau, lui fait une lettre comme quoi il sera correspondant de guerre de ce journal de gauche. Montherlant accompagnera à partir du 20 mai les troupes de la 87e division nord-africaine, qui tenaient la route nationale et ses abords entre Noyon et Saint-Quentin. Il va demeurer trois semaines avec ces troupes, notamment avec le 9ème Zouaves et avec le 18 ème régiment de tirailleurs algériens. Mais il n’est pas “officiel”.
“Les correspondants de guerre officiels étaient promenés en car, dînaient au mess avec les officiers, étaient tous couverts de ceinturons, de bananes et de toutes sortes de choses. C’était un genre que je ne voulais pas.”
Montherlant part pour le Front, entre l’Oise et l’Aisne.
“Je passai trois semaines difficiles parce que je n’étais plus jeune et surtout pas en subsistance nulle part. Je fus ensuite tout le temps arrêté par la police ; en réalité le risquais les plus vilaines histoires. J’étais sur le Front sans titre véritable.”
Durant les combats (mai et juin), Montherlant sera blessé légèrement “par un éclat de bombe ridicule dans l’aîne, tout petit, qui me permit de revenir à Marseille quelques jours avant la déclaration de guerre de l’Italie”.
Montherlant va décrire cette période de mai et juin 1940, dans Textes sous une occupation qui paraîtront en 1953.
Voici l’extrait du Rêve des guerriers (Textes sous une occupation, pages 36 à 38, NRF, 1953) où il raconte comment il fut blessé : il avait dû quitter un abri pour y laisser des soldats s’installer pour la nuit, et alla s’étendre seul à une centaine de mètres plus loin, sur la terre nue, hors d’un bois, mais dans des buissons. Il s’endort.
“Des bombes qui tombaient en chapelet, à intervalles égaux, d’une hauteur médiocre, trouèrent mon sommeil et me réveillèrent. La trajectoire de l’avion venait vers le petit bois avec une régularité impressionnante. Supposé qu’il eût été prudent de bouger, je n’eusse pas bougé. Y avait-il une branche qui dormait sur mon épaule, et que je ne voulais pas réveiller ? Non, mais le pli est chez moi de m’agiter le moins possible dans les moments critiques (…) Les éclatements se rapprochaient toujours. Enfin, sur ma gauche, la terre poussa un cri et s’élança vers le ciel. Aspergé de matières, je compris de suite que tout n’était pas net dans ma cuisse droite. Et ma première réaction fut un : “Ce n’est pas de jeu !” indigné. J’avais trouvé grandiose d’attendre tranquillement l’avion ; mais à cela l’avion devait répondre par une magnanimité égale, c’est -à-dire m’épargner.”
Montherlant est blessé à l’aîne, il saigne. Il fait nuit. Il ignore où trouver un toubib, et pour rien au monde ne veut demander un secours à la troupe qui l’a fait évacuer de son abri. Il place un mouchoir sur la blessure et se rendort.
“A l’aube (qui avait, elle aussi, la vilaine tête blême de quelqu’un qui a beaucoup saigné), j’allai à l’aventure sur la route, en quête d’une ambulance”. Des hommes le rejoignent qui “me témoignèrent quelque intérêt, car, coulant de mes minuscules entailles, un sang indiscret, sans proportion pour la quantité avec le peu d’importance de l’égratignure, avait inondé ma culotte, à croire que tout mon corps s’était vidé (…) Telle fut cette blessure (…) sans pathétique et sans lyrisme. Alors que la veille, tombant de mon haut, pour un faux pas, tandis que je dévalais en courant une pente, j’avais poussé un cri qui était horrible à entendre sortir de soi : le cri d’un grand verrat qu’on égorge.” (Textes sous une occupation, Le Rêve des guerriers (écrit dans l’été 1940), Essais, Pléiade, p.1396 à 1398).
Montherlant quitte les armées le 10 juin 1940, et rejoint le Midi de la France (Marseille et Nice) où il va rester jusqu’en mai 1941. Tournée de conférences.
24 juin 1940 : Armistice
“Le journal sortit, bordé de noir. Mais je suis tellement bête que d’abord, bien que prévenu, je ne compris pas : je crus que quelqu’un de la direction était décédé. Puis je vis une femme qui pleurait. Le seul humain français que j’aie vu pleurer en cette occasion. Elle “sauvait l’honneur” (…) Aujourd’hui l’armistice a été signé. Le 24 juin. Pour le solstice d’été. La croix gammée, qui est la Roue solaire, triomphe en une des fêtes du Soleil.” (Le Solstice, p. 291-292)
Octobre 1940 : Montherlant refuse l’offre d’Alphonse de Chateaubriant de collaborer à La Gerbe, revue pro-allemande.
Mai 1941 : retour à Paris
Octobre 1941, parution du Solstice de juin
 |
|
Le livre est interdit en France par les Allemands durant trois semaines. En Belgique et en Hollande, l’interdiction durera jusqu’à la fin de la guerre.
Dans ce livre, Montherlant dira d’abord “non” à tout ce qui fut la cause de la plus grande défaite de la France et ensuite “oui” à un avenir sous l’étendard de la Roue solaire (ou la Croix gammée), dans l’attente d’une nouvelle renaissance, selon le principe de l’éternel retour…
Difficile à accepter, mais c’est ainsi. Montherlant, dans ce livre magnifique, a raté son analyse, et c’est pour cela qu’à la Libération, il eut quelques soucis, mais ne connut pas l’emprisonnement.
Ce fut aussi la raison pour laquelle certains passages publiés en 1941, disparurent dans les Essais parus en Pléiade en 1963.
L’homme du “NON”
Montherlant est donc, au cours de la plus grande partie du livre un moraliste sévère qui ne se prive pas de faire des remontrances aux Français, jeunes, vieux, étudiants, nantis, gens du peuple ; il va exprimer d’abord sa colère de voir la France défaite. Qui l’a mise dans cet état ? Montherlant lance une série de reproches à ses contemporains et, en même temps, il leur donne des conseils pour se corriger. C’est dans ce livre, plus que dans d’autres œuvres, qu’il va vitupérer la lâcheté, la médiocrité, le manque de courage des Français.
Le Solstice de juin est un livre-coups-de-cravache, et selon moi, même s’il est ambigu, même si sa conclusion peut troubler, il restera un des plus grands essais de Montherlant avec L’Equinoxe de septembre. Montherlant attaque tous azimuts. Par exemple, il reproche aux jeunes leur lourdeur, leur mollesse, et leur propose plus de désinvolture. Il leur recommande d’apprendre la boxe. Aux écrivains, il préconise le courage de parler vrai.
“Un grand destin est promis aux auteurs français qui attaqués, creusés, retournés par les évènements, s’exprimeraient en hommes, et non en mimes ingénieux.”
Il magnifie le courage de celui qui d’instinct “va au canon”, va à l’endroit où il peut recevoir des coups, va du côté où on est le plus haï.
Montherlant a horreur des “déprimés”. Il a quelque chose d’un Patton, le général américain qui, à la fin de la guerre, cravache un soldat en pleine prostration.
Montherlant vante le “bon sens” qui est vertu d’audace. Il conseille à ses lecteurs de “se créer des répugnances.” :
- “Je rêve d’un organisme qui contrôlerait tout ce qui est expression publique.
- “Nous interdisons ceci.”
- “Mais pourquoi ?”
- “Parce que cela est trop bête (ou trop piètre, ou trop vulgaire). Parce que cela vous dégraderait, et mon devoir est de vous protéger malgré vous.”
Montherlant voudrait réveiller la France. Il fut, dans les années 20 et 30, sollicité pour s’impliquer dans le “politique”. Mais après avoir vu de près certaines séances de la Chambre, avant-guerre, il s’est rendu compte qu’il n’aura jamais le goût ni la capacité d’être un homme politique. Parlant d’un dirigeant qui s’adresse aux Français à la radio le 14 juin 1940 (Reynaud ?), il écrit :
“Ce ton faux qui convenait à un peuple qui aimait le faux, vivait dans le faux, et alors ce peuple s’était condamné lui-même.”
Montherlant invite à refuser l’abaissement, la médiocrité, la vulgarité.
“Chaque fois que vous avez dit non à un homme, les yeux dans les yeux, sans le craindre, vous pouvez marquer le jour d’une pierre blanche (…) Ce qui a manqué plus que tout peut-être au peuple français depuis vingt ans, c’est ce “non !” frémissant, jailli des profondeurs. Travaillons à lui donner ce “non !” à ce qui est médiocre et à ce qui est bas.” (Solstice, Essais, Pléiade, p.885 -886).
Montherlant apparait ici comme l’homme du NON, qui se dresse face aux Français pour les fustiger.
Mais Montherlant souffre aussi avec les Français ! Il suggère d’avoir “des pensées qui soutiennent”, comme celles-ci : “Dans l’épreuve, il n’y a qu’à lui opposer le plus vif courage. L’âme jouit de son courage et oublie de considérer le malheur” (Stendhal), ou “Ses malheurs n’avaient pas abattu sa fierté” (Racine), ou la phrase de Dante, lorsqu’il parle de ce damné, dans son Enfer, “plein de dédain pour le supplice qu’il endure”. Montherlant ne se résigne pas. Il secoue. Il est plein d’énergie pour sortir les Français de leur morale de midinette.
“Les dangers, les menaces, les difficultés de toutes sortes qui abondent dans les jours si riches que nous vivons, peuvent être une occasion de resserrement de l’individu - soupirs, tremblotte, mutisme, hypocrisie, inhibition par excès d’inquiétude, - comme ils peuvent être une occasion de tremper le caractère et de faire jouer la liberté d’esprit”.
Montherlant se doute qu’on va lui reprocher trop d’exigence. Il répond : “On est exigeant pour ce qu’on aime”. Il recommande aux écrivains de se préserver, de garder une distance vis à vis de leur époque, et de ne pas réagir sur tout.
“L’écrivain doit répondre aux enquêtes les plus oiseuses, rédiger des messages, pontifier au hasard, guider ses semblables dans des directions mûrement choisies en cinq minutes (…) Il est comme un petit poulet dans une cour, qui se jette à droite, à gauche, avec force piaillements, partout où le rien l’appelle (…) Vienne un jour où il relise ses messages et ses adresses, vieux seulement de six mois, et il se fera pitié (…) Aux écrivains qui ont trop donné, depuis quelques mois, à l’actualité, je prédis pour cette partie de leur œuvre, l’oubli le plus total.” (Solstice, Essais, Pléiade, p.902).
Montherlant demande aux Français d’écarter “les hommes qui font tourner frénétiquement, et presqu’inconsciemment, les moulins à couplets : couplets d’espoir, couplets de confiance, couplets de chauvinisme, couplets d’adulation (…) Je vais jusqu’à croire que le vice du verbiage creux est une des causes de notre décadence.” Dans ce livre, Montherlant montre qu’il faut faire face, “comme le mouvement si vif du lourd taureau, dans l’arène quand, pivotant sur son avant-main, il fait face, successivement, à ceux qui l’attaquent à droite et à gauche.” Depuis combien de temps, constate Montherlant, la France est-elle élevée dans la haine et le mépris de la force ? Soyons forts, écrit Montherlant ! Refusons d’être des gentils. Il analyse l’attitude de la France avant la défaite.
“Combien nous manquons d’agressivité et payons pour ce manque (…) Et l’armée défensive de 39. Et pas de ligne Maginot dans le Nord, parce que les Belges trouveraient que nous ne sommes pas gentils. Et pas d’attaque sur l’Italie, en septembre, parce que la sœur latine trouverait que nous ne sommes pas gentils (…)
Montherlant ne craint pas de dire ses quatre vérités à un peuple vaincu. Il ne le ménage pas. Mais il a la passion de la France aussi. “Etre patriote en France est une crucifixion” (Carnets, 1930-1944). Il ne s’était pas trompé dans les années 30 en prédisant une guerre prochaine ; il fut un des rares écrivains français à s’indigner lors des accords de Munich. Il avait eu raison, et on ne l’avait pas écouté. Et maintenant, il dit aux Français vaincus qu’il est temps de changer leur état d’esprit.
L’homme du “OUI”
Pourquoi, dès lors, Montherlant fut-il inquiété à la fin de la guerre ? Pour le motif d’avoir écrit Le Solstice de juin ? Montherlant ne fut pas un collaborateur ; il refusa l’invitation des Allemands à se rendre à Weimar avec beaucoup d’autres écrivains français pro-allemands, comme Brasillach, Jouhandeau, Bonnard, etc… Pas de trace d’antisémitisme dans son œuvre. Et il refusa de publier dans les journaux ou revues collaborationnistes. Durant toute la guerre, il veilla avec la plus grande prudence à ne pas cotoyer les Allemands.
Voici la réponse de Montherlant, à la fin de sa vie :
“Le Solstice de Juin fut attaqué par certains de la Résistance au moment où on approchait de la fin de la guerre. Mais il ne fut jamais interdit. Je ne passai jamais devant un tribunal quelconque, sauf devant une commission d’épuration de la Société des Gens de Lettres qui m’innocenta complètement et entièrement, puis devant un tribunal d’épuration composé de certains écrivains de la Résistance. Ils devaient être huit à venir, six ne vinrent pas pour des raisons que j’ignore, et je fus donc jugé par deux de mes confrères qui m’infligèrent une peine de six mois rétroactifs de non-publication, ce qui était vraiment très peu et platonique (…) De cette petite séance de jugement (…) ce qu’on me reprochait le plus était un essai intitulé “Les Chenilles” sur lequel on se trompait (de bonne ou de mauvaise foi) complètement. J’y racontais une chose vue souvent : on urine sur une chenille, on la croit morte, noyée, elle relève la tête, on recommence une troisième, une quatrième fois et on se dit : vraiment elle est extraodinaire, laissons cette chenille tranquille. Dans ma pensée c’était une apologie de l’armistice. J’avais vu trois semaines de front, ça m’avait largement suffi pour comprendre qu’il fallait un armistice.” (Archives du XXe siècle, 1971, p. 40).
 |
“Laissons cette chenille tranquille”, cela voulait dire en réalité : “Laissons les Allemands tranquilles ! On a perdu ! La paix maintenant !”. En effet, il faut lire la suite. Montherlant ne cite pas, dans cette interview du 10 mai 1971 reprise dans les Archives du XXe siècle, le dernier paragraphe jamais expurgé des Chenilles :
“Si je me suis étendu sur ce petit jeu (de pisser sur les chenilles), c’est qu’il me semble qu’il n’est pas sans analogie, pour l’esprit, avec celui de la guerre. Faire tout ce qu’il faut pour anéantir l’adversaire. Mais une fois qu’il a montré que c’était lui qui tenait le bon bout, s’allier du même cœur avec lui.” (p. 288, édition 1941).
Voila ce qui lui était reproché : “S’allier du même cœur avec lui !” Et d’autres “juges” aggraveront le dossier en prétendant que Montherlant en pissant sur les chenilles, pissait en réalité sur l’armée française ! Là, il faut beaucoup d’imagination… Sipriot, le biographe de Montherlant, en rajoutera encore :
“En lisant ces textes en 1941, personne n’a douté : “Les Chenilles” sont les foules de l’exode (!) écrasées par les Allemands à qui Montherlant demande de n’être pas impitoyables. C’est le seul sens pausible.” (Sipriot, tome 2 p. 186).
A nouveau ici, on retrouve le parti pris de Sipriot pour noircir Montherlant et dire autre chose que ce qui fut écrit ! Montherlant pissant, au figuré, sur les populations dans l’exode ! Ridicule interprétation.
Malgré ses ennuis à la Libération, Montherlant ne censurera jamais ce dernier paragraphe des “Chenilles”, lors de la publication du Solstice en Pléiade, en 1963, confirmant par là, que les “Chenilles”, c’étaient bien les Allemands, vainqueurs, avec qui les Français seraient obligés de s’allier !
Cependant, certains paragraphes du Solstice furent plus tard censurés par Montherlant. Ce sont ceux où il semble dire : “C’est terminé, on a perdu la partie. Pas de fronde inutile !”, ce sont les passages où il donne des conseils de conduite à suivre après la défaite. Et dans ces passages, ce n’est plus le révolté qui parle, il s’agit d’un autre personnage, c’est le Montherlant de l’alternance, le Montherlant du “OUI” cette fois, qui accepte la défaite, car, pour lui, tout est joué, et qui préconise d’attendre que, plus tard, les évènements fassent revenir un nouveau christianisme ! Après cette défaite, “nous verrons remonter un âge chrétien. Le second christianisme, frais et pur, lavé dans quoi ? Peut-être dans le sang. Comme il nous paraitra beau ! Comme il nous aura manqué ! Nous l’accueillerons avec des sanglots. Et il sera vrai une seconde fois.” (Solstice, p. 314).
Voici donc, pour illustrer ce “OUI” après la défaite, les passages, qui furent censurés par Montherlant, et qui se trouvent page 303 et suivantes, de l’édition de 1941 :
“Pas de lamentations, d’abord (la première des disciplines). Pas de bouderie (et le temps des remords mêmes me semble dépassé). Pas de petite fronde, puérile et sordide, par laquelle on se donne l’illusion ou le masque du patriotisme, et qui lui est une insulte : c’est avant et pendant qu’il fallait chercher à embêter l’adversaire, non après. Pas de violence qui ne saurait être que verbale, et la violence impuissante, rien de plus laid. Pour une fois, être beau joueur. Ne pas entrer dans l’avenir en rechignant. Nous retourner du tout et dire oui de bon cœur, à ce qui vient d’arriver. Double acceptation : de la réalité en tant que telle ; puis d’un évènement juste : nous avons été battus on ne peut plus régulièrement, et à tous les degrés. Acceptation. Ensuite, adhésion (…).” (Le Solstice de juin, Grasset 1941, p. 311-312).
C’est pourquoi, on comprend mieux, peut-être, à la lecture de ces lignes - écrites en juillet 40, en pleine catastrophe - et expurgées ensuite, pourquoi Montherlant, à la Libération, eut quelques ennuis, ennuis jamais digérés par lui, d’ailleurs. Il s’était trompé. Il n’avait pas appelé à la Résistance. Il n’aimait pas de Gaulle, il s’était abstenu de toute lutte contre l’Occupant, et à la Libération, il fut même obligé de se cacher quelques jours chez des amis, craignant même pour sa vie, quand on tuait ou emprisonnait, à tort et à travers, ceux qui de près ou de loin avaient collaboré ! Ce fut certainement un échec pour Montherlant, trop pessimiste, de n’avoir pas prévu que les Alliés finiraient par vaincre l’Allemagne. C’est pourquoi, il n’appela pas à la révolte ni ne s’engagea à Londres ou en Afrique du Nord pour continuer le combat. Quel retentissement aurait eu cette voix célèbre si elle avait dit “NON” aux Allemands, au lieu de dire “OUI” de bon cœur !
Mais, en France, les nazis l’auraient fait taire, l’auraient arrêté ou déporté. Il serait mort. La mort de Montherlant à ce moment aurait fait de lui un héros. On peut rêver. Il a préféré poursuivre son œuvre en se retranchant Quai Voltaire, et en prenant de plus en plus de distance avec la société.
Néanmoins, écrire La Reine morte, durant l’Occupation, et la faire jouer à la Comédie Française, durant 100 représentations, montrera de la part de Montherlant, face aux Allemands, un certain courage, et donnera à de nombreux Français, qui comprenaient les allusions de la pièce, un peu d’air frais dans cette période sinistre. Il suffira de lire quelques citations ci-dessous, extraites de cette pièce, pour prendre conscience que certaines phrases pouvaient heurter les Allemands ou Vichy.
Mais Montherlant, contrairement à d’autres écrivains à la Libération, ne connut pas le cachot ! Il n’était pas un collaborateur ! Montherlant, déjà blessé en 1918, avait vu sur place l’effondrement des armées françaises de 1940. Il jugeait l’armistice nécessaire et évidente pour arrêter le massacre, et complètement écœuré, indigné, avait écrit Le Solstice pour clamer sa douleur. Ensuite, il se replia sous sa tente, pour poursuivre son œuvre.
Après 1945, plus jamais Montherlant ne prendra de positions “politiques” aussi engagées que celles du Solstice, dans ses écrits en forme d’Essais. Replié dans son appartement au bord de la Seine, il exprimera son mépris et ses colères “politiques”, au travers des personnages de son théâtre. Je songe à La Reine morte, à Port-Royal, au Cardinal d’Espagne, et à La Guerre civile, notamment.
Cette philosophie de l’alternance très chère à Montherlant, avec le mythe solaire de la Roue qui tourne et annonce une résurrection de la France - mais dans combien de temps ? - déplut profondément aux milieux catholiques qui comprenaient que Montherlant ne défendait pas le Christianisme. Sipriot cite une intéressante lettre de Michel de Saint Pierre, cousin de Montherlant, qui s’oppose à la conception du temps circulaire chère à Montherlant, car ce temps est la négation du temps placé sous la protection de la Providence :
“S’il (Montherlant) persiste à renier la lumière et à lancer contre le Christianisme, comme des pierres vers une étoile, la fausse accusation et les blasphèmes, s’il ne daigne comprendre ce que nous attendons et espérons de son vaste talent, alors il nous faudra désespérer de Montherlant et nous détourner de lui.” (Michel de Saint Pierre, Tribune des Jeunes, cité par Sipriot, Biographie, tome 2, p. 191).
Mais Michel de Saint Pierre ne se détourna jamais de son cousin. Il fut l’un des derniers à recevoir de lui une lettre le jour même du suicide en 1972.
 |
1942, La Reine morte
L’administrateur de la Comédie-Française, Jean-Louis Vaudoyer, pousse Montherlant à écrire une pièce de théâtre et lui soumet trois volumes du théâtre espagnol, dont une pièce d’un espagnol du XVI° siècle, Guevara. Montherlant lit cette œuvre, qui mûrit en lui, et puis conçoit sa Reine morte sans suivre le modèle Guevara proposé par Vaudoyer. Il part à Grasse, chez son amie Marguerite Lauze, et écrit cette pièce en cinq semaines. Voici comment Montherlant décrit son travail :
“Je travaillais dans la campagne de Grasse, aussi ennuyeuse que l’est toute campagne (…) Pourtant, même assis le cul en terre, parmi les épouvantables délices de la res rustica, je veux dire le soleil qui vous aveugle, le vent qui surexcite vos feuillets, les mouches, les vers de terre, les fourmis, les chenilles, les toiles d’araignée, les tessons de bouteille et les étrons, je connaissais ces moments extraordinaires, quand le sang aux joues, l’accélération des battements du cœur, le frisson dans le dos, etc. communiquent à l’artiste la sensation d’un état sacré. Ces phénomènes, et la facilité inouïe de la création romanesque (surtout de la création dramatique, dont la facilité et la rapidité me paraissent monstrueuses), nous donnent alors l’illusion du miracle…” (Théâtre, Pléiade, p. 181).
Résumé
Ce sera un drame en trois actes. Les personnages principaux sont : le Roi Ferrante, lassé de tout, l’Infante de Navarre, femme supérieure, et la douce Inès de Castro.
“Le roi Ferrante voudrait que son fils, Pedro, épousât l’Infante de Navarre. Mais Pedro a secrètement épousé Inès de Castro, et en attend un enfant. Ferrante, qui reproche à son fils d’être “médiocre et grossier”, ordonne qu’on l’arrête lorsqu’il a la révélation de ces faits. Quant à Inès, après beaucoup d’hésitation, le roi Ferrante finira par la faire assassiner. Par raison d’état ? Non pas. Gratuitement ? Pas davantage. Le roi Ferrante est une âme d’ombre, pleine d’incohérences et d’étrangetés, une âme qui se brûle elle-même, pour qui, tout, désormais, est inutilité. La raison de Ferrante est “sa haine de la vie”.” (Perruchot, Montherlant, nrf, p.130).
“Ce caractère du Roi Ferrante est, à coup sûr, dans sa magnétique désolation, l’une des plus extraordinaires créations du théâtre de tous les temps.” (Perruchot)
“Avoir écrit “La Reine morte” suffit à justifier une vie.” (Maurice Maeterlinck)
“Cette œuvre est d’une portée et d’une lucidité aveuglantes.” (Sipriot, Biographie, tome 2, p.212)
Les répétitions commenceront le 26 octobre. La générale, le 9 décembre, fut tiède. Maigre ration d’aplaudissements. Jean Yonnel est le roi Ferrante. Montherlant apprécie beaucoup “sa présence léonine, son orgue magnifique, ses rugissements féroces, gémissements qui sont la voix de la mort” (Théâtre,Pléiade, p.188). Montherlant sera très élogieux aussi pour les actrices, Madeleine Renaud et Renée Faure.
La pièce reçut un accueil moyen de la critique, mais le public fut, ensuite, très chaleureux. La Reine morte fut jouée dans presque tous les pays d’Europe, et fut avec le Soulier de satin de Claudel et Les Mouches de Sartre un des grands succès de l’Occupation.
Après la guerre, La Reine morte sera reprise à la Comédie-Française en 1948, en 1954, en 1957, en 1959 (festival d’Angers). En 1966, le metteur en scène belge, Claude Volter, avec l’accord de Montherlant, transpose la pièce à la Cour de François-Joseph à Vienne.
Citations choisies dans La Reine morte
Acte I
-
“Plutôt perdre que supporter.” (L’Infante)
Tombeau d’Inès de Castro, la Reine morte,
au Monastère d’Alcobaça (Portugal). - “On croit mourir de dépit et de rage, et rien ne passe comme une insulte.” (Ferrante)
- “La pire colère d’un père contre son fils est plus tendre que le plus tendre amour d’un fils pour son père.” (Don Manoël)
- “Chaque fois qu’on me loue, je respire mon tombeau.” (Ferrante)
- “Au jour du Jugement, il n’y aura pas de sentence contre ceux qui se seront tus.” (Ferrante)
- “On dit toujours que c’est d’un ver que sort le papillon ; chez l’homme, c’est le papillon qui devient un ver.” (Ferrante)
- “Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire.” (Ferrante)
- “Un roi se gêne, mais n’est pas gêné.” (Ferrante)
- “Mais ces baisers entre parents et enfants, ces baisers dont on se demande pourquoi on les reçoit et pourquoi on les donne…” (Ferrante)
- “Allez, allez, en prison ! En prison pour médiocrité.” (Ferrante)
- “C’est curieux, les hommes de valeur finissent toujours par se faire arrêter.” (Pedro)
Acte II
- “Il faut être dans la mauvaise foi comme un poisson dans l’eau.” (Don Eduardo)
- “Il ne faut pas être dans la mauvaise foi comme un poisson dans l’eau, mais comme un aigle dans le ciel.” (Ferrante)
- “Ce qui est effrayant dans la mort de l’être cher, ce n’est pas sa mort, c’est comme on en est consolé.” (Egas Cœlho)
- “On tue et le ciel s’éclaircit. En vérité, il est stupéfiant que tant d’êtres continuent à gêner le monde par leur existence, alors qu’un meurtre est chose relativement si facile et sans danger.” (Egas Cœlho)
- “Baisons la main que nous ne pouvons couper.” (Ferrante)
- “Tout vice que le Roi approuve est une vertu.” (Ferrante)
- “Un jour vous serez vieux vous aussi. Vous vous relâcherez. Vos secrets sortiront malgré vous. Ils sortiront par votre bouche trop molle et tantôt trop crispée, par vos yeux trop mouvants, toujours volant à droite et à gauche en vue de ce qu’ils cherchent ou en vue de ce qu’ils cachent.” (Ferrante)
- “O Royaume de Dieu, vers lequel je tire, je tire, comme le navire qui tire sur ses ancres !“ (Ferrante)
- “Il n’y a que les imbéciles pour savoir servir et se dévouer : les seuls qui me sont dévoués sont des incapables.” (Ferrante)
- “La plupart des affections ne sont que des habitudes ou des devoirs qu’on n’a pas le courage de briser.” (Ferrante)
- “Que m’importe le lien du sang ! Il n’y a qu’un lien, celui qu’on a avec les êtres qu’on estime ou qu’on aime (…) On devrait pouvoir rompre brusquemment avec ses enfants, comme on le fait avec ses maîtresses.” (Ferrante)
- “Ah ! assez ! assez ! Deux êtres ne peuvent donc pas s’étreindre sans qu’il y ait des hommes qui se dressent et qui leur disent : “Non ” ? (Ferrante)
- “Aimer, je ne sais rien faire d’autre.” (Inès)
Acte III
- “Et je vois que de tout ce que j’ai fait et défait, pendant plus d’un quart de siècle, rien ne restera, car tout sera bouleversé, et peut-être très vite, par les mains hasardeuses du temps.” (Ferrante)
- “Supporter ! Toujours supporter ! Oh ! cela use. Etre sans cesse dans les mains des hommes !” (Ferrante)
- “Heureux celui de qui les enfants ne portent pas le nom.” (Ferrante)
- “Il y a toujours quelques heures où un homme fort est si faible, moralement et physiquement - tout étonné de tenir debout, - qu’en le poussant un peu on le ferait tomber. Par chance, il est rare que l’ennemi flaire ces heures. Ah ! s’il savait !” (Ferrante)
- “Quand on vieillit, les colères deviennent des tristesses.” (Ferrante)
- “La cruauté est le seul plaisir qui reste à un vieillard, cela remplace pour lui l’amour.” (Ferrante)
- “Les remords meurent, comme le reste. Et il y en a dont le souvenir embaume.” (Ferrante)
- “Aux chefs d’Etat, on demande volontiers d’avoir de la charité. Il faudrait aussi en avoir un peu pour eux. Lorsqu’on songe aux tentations du pouvoir absolu, y résister, cela demande le respect.” (Ferrante)
- “Le bruit de la vérité les épouvante comme la crécelle d’un lépreux.” (Ferrante)
- “Je crois que toute femme qui enfante pour la première fois est en effet la première femme qui met au monde.” (Inès de Castro)
- “O mon Dieu ! dans ce répit qui me reste, avant que le sabre repasse et m’écrase, faites qu’il tranche ce nœud épouvantable de contradictions qui sont en moi, de sorte que, un instant au moins avant de cesser d’être, je sache enfin ce que je suis.” (Ferrante)
1943, Fils de personne
Drame en quatre actes. Création au Théâtre Saint-Georges.
A Cannes, durant l’hiver 1940-1941, Georges Carrion, un avocat, a retrouvé par hasard un fils qu’il a eu jadis mais n’a pas reconnu, et la mère de cet enfant, Marie. Georges et Marie se vouvoient. Le père et le fils se tutoient. Le fils aime sa mère, et est une déception pour le père. Georges s’est enthousiasmé pour ce fils retrouvé, Gillou, à qui il consacre dorénavant un jour et demi par semaine. Mais entre le père et le fils, des heurts se produisent bientôt. Gillou n’est pas de bonne qualité. Gillou est un “médiocre”.
“Mon fils est pour moi une cruelle épreuve. Ma part la meilleure et mon moi profond sont par lui opprimés. Tout ce qui, à mes yeux, donne du prix à la vie, non seulement aux siens ne compte pas, mais est l’objet de sa dérision (…) Un enfant, et c’est le mien, me fait honte pour l’homme.”
Nous sommes donc dans un trio familial. Le père, Georges, de structure rigide, ne supportant pas la vulgarité du “monde moderne”, un peu caractériel, autoritaire, sûr de lui, et qui veut absolument que son fils ait un “minimum” de qualité. La mère, Marie, qui vit au quotidien, pas intellectuelle, partagée entre un fils qu’elle aime sans se poser trop de questions et Georges, pour qui elle n’a pas d’affection, mais qui la soutient financièrement, et qu’elle essaie de ne pas affronter trop directement. Le fils, Gillou, 14 ans, trop jeune encore, manquant d’intelligence et de maturité, que les remontrances de son père ennuient, et qui s’amuse avec des choses vulgaires.
Pour Montherlant, la “qualité” est la raison d’être de la pièce.
“Un père rejette son fils parce que celui-ci est de mauvaise qualité. Si le public ne perçoit pas cette mauvaise qualité, et n’en est pas aussi écœuré que le père, ce dernier lui paraîtra monstrueux.” (Théâtre, Pléiade, p. 213).
Montherlant déplorera que ce mot de “qualité” ne soit plus compris du public.
De toutes ses pièces, c’est celle que Montherlant préfère. D’abord, son texte est clair, simple “décharné”. Pas d’effets, pas de maximes ou de belles citations. Tout se passe dans le studio d’une villa meublée. Episode de la vie privée de Montherlant ? On pourrait le penser, sans certitude.
Voici ce qui fut écrit dans un Paris-Match d’octobre 1972, quelques semaines après le suicide de Montherlant :
 |
|
|
Marguerite Lauze (cc 1926). |
“Marguerite Lauze, chez qui Montherlant écrira “La Reine morte” à Grasse, avait un enfant, Jean-Claude. Montherlant les retrouvera (à Grasse) en 1940, et c’est eux qui allaient devenir ses héritiers, la famille de celui qui ne voulait pas avoir de famille. Au milieu des malheurs de l’occupation la jeune femme, professeur au collège des jeunes filles de Grasse, fut arrêtée pour avoir tenu des propos hostiles à Vichy. Montherlant obtient de Jérôme Carcopino, alors ministre de l’Instruction publique, sa libération. C’est après avoir retrouvé Marguerite, et son fils Jean-Claude, qu’il appelle d’ailleurs toujours Claude, que Montherlant va écrire Fils de personne, un drame qui se passe à Cannes durant l’hiver 1940 : un homme retrouve par hasard un fils qu’il a eu jadis mais n’a pas reconnu, et la mère de cet enfant.”
Sur deux pages du Paris-Match, on voit la photo de Marguerite Lauze jeune, puis la photo de Marguerite Lauze plus âgée, grand-mère, entourée de Jean-Claude Barat, de l’épouse de Barat et de trois petits-enfants Barat.
Dans une lettre inédite que Montherlant m’adressa, le 5 octobre 1961, suite à une étude que je lui avais envoyée sur Fils de personne, il m’écrit qu’il “est toujours en relation avec celui qui fut le prototype de Gillou”. Donc dix-huit années après la publication de Fils de personne ! Pourquoi Montherlant n’aurait-il pas pu connaître l’expérience de la paternité ? Montherlant est un être très complexe, une personnalité “totale” qu’il faut se garder de classer ou de caricaturer une fois pour toutes.
“Quand je repense à cette pièce, et non sans quelque mélancolie, car il me semble que plus jamais je n’écrirai quelque chose d’aussi simple, et d’une ligne aussi pure….” (Montherlant, note III sur Fils de Personne, Pléiade, Théâtre, p. 279).
Voici la dernière scène acte IV, scène III, où Georges, le père, s’exprime :
“Je l’ai sacrifié (Gillou) à l’idée que je me fais de l’homme. Elle (Marie) l’a sacrifié au besoin qu’elle a de l’homme. Chacun de nous, elle et moi, parlait du sacrifice qu’il faisait. Et c’est lui seul (Gillou) qui était sacrifié. Fils de la Femme ? Non, fils de personne. Fils de personne, comme les autres. Mais que ce qui est commencé soit poursuivi sans faiblir. Ne cédons pas à ce transport qui me pousse à l’arracher à elle, et à l’arracher à elle si vainement (…) Ah ! force affreuse ! Je ne verrai plus ses cahiers tachés d’encre traîner sur toutes les tables, ni ses timbres, ni son quadrimoteur… Dieu, affermissez-moi ! Tandis qu’il est là pour quelques instants encore, avant de n’être plus là pour jamais, donnez-moi déjà l’oubli de tout ce qu’il fut. Dieu des rigueurs humaines, Dieu des tendresses humaines, faites que jusqu’au bout je reste assez dur avec lui pour arrêter sur ses lèvres le petit mot qui me bouleverserait, et qui mettrait en moi, au lieu de la paix des choses justes, un remords éternel, une éternelle horreur.” (Théâtre, Pléiade, p. 261).
1943-1944 : Montherlant écrit Malatesta
Sipriot, biographe de Montherlant, va éclairer le travail caritatif de Montherlant durant ces deux années.
 |
En effet, Montherlant travaille activement à l’Oeuvre de l’Assistance aux enfants éprouvés par la guerre dirigée par Odette Michéli, déléguée de la Croix-Rouge qui s’occupe de placer, dans des centres d’hébergement ou dans des familles suisses, des enfants en mauvaise santé, suite aux privations subies durant l’Occupation. Il l’avait rencontrée en 1942.
Pour Montherlant, “les Suisses ont recueilli et couvert de gâteries, choyé, vêtu, quantité d’enfants pauvres, ou plutôt crevant de faim.” Montherlant fera don d’une partie de ses droits d’auteur à cette œuvre. Il racontera cette expérience d’assistance dans son livre L’Etoile du soir qui paraitra en 1949.
Odette Michéli écrira une lettre magnifique à l’avocat de Montherlant, en octobre 1944, quand se mettent en place les tribunaux de la Libération. Voici un extrait de cette lettre :
“Montherlant s’est occupé activement de notre œuvre (…) Il m’a conseillée au moment de la création de notre principal centre d’enfants, à Saint-Laurent du Jura, m’apportant une aide non seulement morale et intellectuelle, mais faisant aussi à la Croix-Rouge suisse des dons très généreux. (…) Il était le seul écrivain français de cette importance qui eût marqué un sens social et une compréhension aussi active du travail que nous essayions de faire en France (…) Il est le seul qui soit entré en contact direct avec les dirigeants de notre œuvre en Suisse et qui ait correspondu avec eux.”
Mars 1944 : perquisition de la Gestapo au domicile de Montherlant.
Septembre 1944, un Manifeste des écrivains français demande le “juste châtiment des imposteurs et des traîtres”. Montherlant n’est pas nommé.
Des Résistants reprochent à Montherlant de s’être dérobé à certaines responsabilités. Montherlant répond qu’il ignorait tout de la Résistance. Léon-Pierre Quint, membre du Comité national des Ecrivains résumera le dossier Montherlant :
“La seule accusation qui pourrait être reconnue contre lui, ce n’est pas d’avoir pris un mauvais parti, c’est de n’avoir pas pris de parti du tout ; il s’agirait de savoir si un écrivain a le droit, pendant l’occupation de son pays, de rester indépendant et de vouloir garder sa liberté d’esprit, - s’il est autorisé, alors que deux camps se disputent le monde, à se tenir à l’écart.”
Le “Dossier Montherlant” sera examiné tour à tour par :
- en septembre 1944, la Direction générale des services spéciaux du 2ème Bureau : non lieu ;
- en février 1945, la Commission d’épuration de la Société des gens de lettres ne retient aucune charge contre l’écrivain, après l’avoir entendu ;
- un tribunal d’épuration composé de certains écrivains de la Résistance lui infligèrent une peine (une interdiction professionnelle) de six mois rétroactifs de non-publication. Ils furent deux “juges” sur huit à se déplacer pour entendre Montherlant ! (voir plus haut, Le Solstice de Juin) ;
- en mai 1945, la Haute Cour classe l’affaire suite à une information contre Montherlant ;
- été 1945, information contre Montherlant devant la Chambre civique : classement sans suite. Il n’y aura jamais d’instruction.